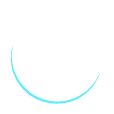C’est un plaisir d’être ici à Stanford. Merci au Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) et au King Center on Global Development pour leur invitation.
Au moment où nous nous réunissons dans cette prestigieuse institution, l’économie mondiale – en particulier le monde en développement – fait face à une dure réalité. La conjugaison d’une série d’événements difficiles et de politiques macroéconomiques inédites est en train de plonger le développement dans une crise. Une situation qui a des conséquences pour nous tous en raison des interconnexions de l’économie mondiale et des civilisations du monde.
La mission du Groupe de la Banque mondiale consiste à alléger la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Nous mobilisons des fonds propres et les contributions annuelles de nos actionnaires pour accorder des dons et des prêts aux pays en développement afin de les aider à mettre le doigt sur leurs problèmes de développement et à y apporter des solutions. Ces dernières années, nous avons considérablement augmenté nos financements aux pays en développement, en particulier ceux affectés à l’action climatique, qui ont atteint 31,7 milliards de dollars au cours de l’exercice 22.
Notre rapport sur la pauvreté et la prospérité partagée, qui va bientôt paraître, indique que le ralentissement des progrès en matière de développement a commencé bien avant la pandémie de COVID-19, ce qui est préoccupant pour la mission qui est la nôtre. Ce rapport montre que la pauvreté n’a cessé de reculer pendant les années 1990 et 2000, que les progrès ont ralenti en 2015 et qu’environ 70 millions de personnes de plus ont basculé dans l’extrême pauvreté lorsque la pandémie a éclaté. Il fait également état d’une contraction du revenu médian mondial de 4 %, la première depuis que nous avons commencé à mesurer cet indicateur en 1990.
Conséquences humaines de crises concomitantes
Les perspectives à court terme s’annoncent extrêmement moroses pour le monde en développement, du fait de la forte hausse des prix des denrées alimentaires, des engrais et de l’énergie, de l’augmentation des taux d’intérêt et de leurs écarts, de la dépréciation monétaire et des sorties de capitaux. Avec les politiques actuelles, il faudrait des années pour diversifier la production énergétique mondiale en se départant de la Russie, ce qui prolongerait le risque de stagflation évoqué dans l’édition de juin 2022 des Perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale.
Ces ondes de choc ont touché le développement à un moment où de nombreux pays en développement éprouvent également des difficultés dans d’autres domaines : gouvernance et état de droit ; viabilité de la dette ; adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets ; et budgets publics limités pour parer au coup porté au développement par la pandémie de COVID-19, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation.
Les conséquences humaines de ces crises concomitantes sont catastrophiques. La pandémie de COVID-19 – qui à elle seule a fait plus de six millions de morts –, les conflits géopolitiques et les phénomènes météorologiques extrêmes ont frappé les pays et les populations partout dans le monde, les pauvres en payant le plus lourd tribut, surtout les femmes et les filles.
Les données de la Banque mondiale montrent que la pauvreté des apprentissages touche 70 % des enfants des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire – il s’agit de la proportion d’enfants incapables de lire ou de comprendre un texte simple à l’âge de 10 ans. La COVID-19 a aggravé la crise mondiale de l’apprentissage et est à l’origine du pire choc jamais subi par l’éducation et l’apprentissage. Qui plus est, de nouveaux défis se profilent déjà, sous forme de pressions démographiques : selon les projections démographiques de l’ONU, d’ici à 2030, plus d’un enfant sur quatre en âge de scolarisation dans le primaire vivra en Afrique subsaharienne, région qui affiche le taux de pauvreté des apprentissages le plus élevé. Cette situation indique que, aujourd’hui, les systèmes éducatifs sont bien loin d’assurer une éducation de qualité pour tous.
Les récentes inondations au Pakistan ont fait plus de 1 500 morts. La sécheresse fait des ravages dans la Corne de l’Afrique et en Amérique du Sud, portant un coup à la production alimentaire et hydroélectrique et plongeant neuf millions de personnes supplémentaires dans une grave insécurité alimentaire rien qu’en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Les pays en développement sont frappés par des catastrophes climatiques plus fréquentes et plus graves. Les émissions de gaz à effet de serre causées par l’homme ont pour conséquence le changement climatique, qui par ricochet a des répercussions tragiques multiformes sur le développement. L’adaptation tant des pays que des populations touchés par le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont des mesures qui s’imposent de toute urgence. Le Groupe de la Banque mondiale consacre l’essentiel de ses ressources et accorde sa plus grande attention à cet ensemble de défis. Il n’a pas financé de nouveaux projets liés au charbon depuis 2010 et s’emploie activement avec les pays en développement et les partenaires de la communauté internationale à inverser la tendance à l’utilisation accrue de combustibles à forte émission de carbone. Pour autant, avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la limitation des approvisionnements en gaz naturel et l’augmentation des prix, on observe des reports des dates de fermeture des centrales électriques à charbon partout dans le monde et une accélération de l’exploitation du charbon.
Face à ces crises qui se superposent, un danger imminent pour le monde en développement est que le net ralentissement de la croissance mondiale se mue une récession mondiale, comme l’explique la Banque mondiale dans un rapport publié en septembre. En 2021, le PIB mondial par habitant a à peine dépassé son niveau d’avant la pandémie, mais de nombreux pays en développement n’ont pas atteint leurs niveaux de revenu par habitant d’avant la pandémie. Les États-Unis ont enregistré une contraction de leur PIB au cours des deux premiers trimestres de 2022. La forte baisse des cours des actifs dans le monde n’est pas sans conséquence sur les bilans fragilisés des entreprises et des caisses de retraite, et pourrait freiner de nouveaux investissements. L’économie chinoise s’est fortement ralentie en raison des mesures de confinement liées à la COVID-19, ce qui a poussé la Banque mondiale à réviser ses prévisions de croissance pour la Chine en 2022 en les ramenant à 2,8 %, contre 5 % en avril. L’Europe est confrontée à la flambée soudaine des prix énergétiques causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les rigidités du marché. La faiblesse de l’euro et le niveau élevé de l’inflation augmentent la probabilité d’une récession en Europe et assombrissent davantage les perspectives de croissance à long terme de la zone euro.
Au-delà de ce net ralentissement cyclique, les pays en développement sont confrontés au risque de voir perdurer au-delà de 2023 les tendances à l’œuvre dans les économies avancées : inflation, ralentissement de la croissance, baisse de la productivité, épuisement des approvisionnements énergétiques mondiaux et hausse des taux d’intérêt. Si les politiques budgétaires et monétaires actuelles deviennent la nouvelle « normalité », cela se traduira par une forte absorption des capitaux mondiaux par les pays avancés, avec pour effet de faire perdurer le sous-investissement dans les pays en développement et d’entraver la croissance future. Tel était l’objet de mon allocution au Churchill Symposium à l’Université de Zurich en mai, qui a porté sur la stagflation, la mauvaise répartition des capitaux et le coût de la réorientation énergétique de l’Europe.
Les défis macroéconomiques auxquels est confronté le développement ne sont pas sans conséquence et s’aggravent probablement. J’y reviendrai dans un instant, mais je tiens déjà à noter que de nombreux autres aspects de la crise du développement appellent également des efforts à l’échelle mondiale. Il s’agit notamment de l’afflux d’armes en Afrique, qui a des effets dévastateurs, de la fragilité politique qui en résulte, de l’adaptation au changement climatique, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la violence et du dénuement auxquels sont confrontées les femmes et les filles, et des graves revers essuyés en matière d’éducation, de santé et de viabilité de la dette dont j’ai parlé précédemment. Le Groupe de la Banque mondiale travaille beaucoup dans chacun de ces domaines, et j’aimerais ici souligner ce travail et remercier les membres de notre personnel.
Pour juguler les crises, le Groupe de la Banque mondiale a opposé une riposte dont la célérité, l’ampleur et l’impact étaient sans précédent, en déployant des financements d’un montant record de 115 milliards de dollars au cours de l’exercice 22. Nous avons intensifié nos engagements sur le plan des financements, des analyses et des conseils aux pouvoirs publics, par vagues successives, initialement pour répondre à la pandémie de COVID-19, et maintenant pour faire face à la crise alimentaire et énergétique, à la guerre en Ukraine et à ses retombées. La guerre infligée par la Russie a causé des pertes en vies humaines et des destructions. La Banque mondiale a mobilisé 13 milliards de dollars de financements d’urgence auprès de partenaires bilatéraux et de partenaires de développement, dont environ 11 milliards ont déjà été décaissés dans le cadre de nos projets et fonds fiduciaires.
Dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, le Groupe de la Banque mondiale est de loin la principale source de financements climatiques dans le monde en développement et un chef de file en matière de diagnostics climatiques, de réduction des émissions de méthane et de financements climatiques innovants. Nous sommes également la plus importante source extérieure de financement de l’éducation dans les pays en développement, une grande partie de nos ressources étant allouée sous forme de dons et de prêts hautement concessionnels par l’IDA, le fonds de la Banque mondiale au service des 75 pays les plus pauvres, et à travers des fonds fiduciaires connexes. Le défi sanitaire est tout aussi immense et englobe le besoin d’un large éventail de vaccins vitaux et la préparation aux crises sanitaires futures. Avec l’appui et le leadership soutenus des États-Unis, nous venons de lancer un nouveau fonds fiduciaire pour la prévention des pandémies et la préparation et la riposte à ces dernières (PPR), qui évaluera et renforcera la préparation sanitaire dans le monde en développement. Chacun de ces défis et chacune de ces crises nécessitent une attention et des ressources mondiales d’urgence.
Faire face à des politiques budgétaires et monétaires inédites
Le reste de mon propos aujourd’hui porte essentiellement sur le défi macroéconomique – l’arbitrage entre les politiques budgétaires et monétaires dans les économies avancées et le défi qu’elles posent pour la stabilité et l’investissement dans les pays en développement. Le SIEPR est un cadre important pour en parler, et je vous remercie de l’intérêt que portez à ces questions.
Au cœur de la crise macroéconomique qui touche le développement se trouve le changement profond des politiques budgétaires, monétaires et financières des économies avancées depuis la crise financière de 2008. Les politiques monétaires menées au cours de la dernière décennie ont orienté les capitaux vers des segments de l’économie mondiale qui n’en manquent pas – États, sociétés émettrices d’obligations et particuliers fortunés – au détriment d’une croissance et d’un développement généralisés. La formation brute de capital fixe dans les pays en développement stagne, alors même que les prix des actifs ont bondi dans les économies avancées. La perspective de la poursuite de ces politiques crée le risque de sous-investissement dans le développement durant des décennies. On observe clairement quatre aspects : premièrement, l’ampleur du changement des politiques macroéconomiques ; deuxièmement, la grande envergure de ces politiques ; troisièmement, l’impact sur la répartition globale des capitaux ; et quatrièmement, le risque que ces politiques se pérennisent et entravent le développement.
À partir de 2008, les économies avancées ont adopté des politiques monétaires totalement nouvelles pour lutter contre la crise financière mondiale. Les banques centrales ont fixé les taux d’intérêt à zéro voire moins, et ont acheté des obligations financées en utilisant les réserves bancaires excédentaires qu’elles ont elles-mêmes accumulées. Ces activités centrées sur la crise financière ont contribué à contenir l’impact de cette dernière. Pour autant, comme l’a déclaré Larry Summers en 2021 « ... le commencement de la sagesse, c’est lorsqu’on se rend compte que la prescription de mesures d’assouplissement quantitatif ne tient pas la route aujourd’hui ».
Des années d’application de taux d’intérêt extrêmement bas et d’expansion massive de la base monétaire contrôlée par une réglementation généralisée du crédit se sont traduites par l’apparition d’un régime monétaire radicalement nouveau. En effet, le monétarisme a cédé la place au post-monétarisme, où les spécificités de la réglementation du crédit et le choix des banques centrales de détenir des obligations ont pris le pas sur la masse monétaire. La base monétaire a été décuplée durant la première décennie de mise en œuvre de cette nouvelle politique sans conséquence sur l’inflation, parce que les politiques réglementaires limitaient la multiplication de la monnaie qui aurait eu lieu dans l’ancien système de réserves obligatoires. C’est ainsi que les devises sont restées relativement stables, mais l’inflation a été vulnérable aux chaînes d’approvisionnement et à l’excès de politiques budgétaires.
Je vais évoquer trois effets secondaires de ces nouvelles politiques. Premièrement, avec les rendements qui subissent la pression des achats d’obligations par les banques centrales (ou, dans le cas du Japon, les rendements étant plafonnés à un niveau très bas), on observe une quête du rendement qui favorise l’augmentation des prix sur certains marchés d’actifs, tels que l’immobilier et les obligations. L’application de ces politiques monétaires pendant de longues périodes favorise un éloignement des prix des actifs de leur valeur intrinsèque. Dans les pays en développement, cela s’est traduit par la faiblesse des rendements des obligations d’État et des coûts d’emprunt, qui attire les capitaux vers des activités improductives. Pourtant, le manque de fonds de roulement pour le financement du commerce et le financement à court terme, représentant une part croissante des actifs à court terme des banques internationales, s’est transformé en prêts porteurs d’intérêts accordés aux banques centrales.
Deuxièmement, l’offre de taux d’intérêt bas sur de longues périodes a peu incité les entreprises à assainir leurs bilans et les gouvernements à entreprendre des réformes structurelles. Il est établi que les programmes d’achat à grande échelle d’actifs ont favorisé la présence de banques et d’entreprises zombies, ce qui signifie que la destruction créatrice ne s’opère pas, mettant ainsi à mal le potentiel de croissance de l’économie. Une étude de la Banque des règlements internationaux (BRI) montre que la part des entreprises zombies – celles dont le rapport entre la valeur marchande de leurs actifs et leur coût de remplacement (Q de Tobin) est inférieur au ratio médian dans leur secteur – dans les économies avancées est passée de 5 % en 2000 à plus de 12 % en 2018, entraînant une mauvaise répartition des capitaux qui inhibe la croissance de la productivité et augmente le coût du capital nécessaire à un développement rationnel.
Le marché états-unien des obligations d’entreprises de première catégorie nous offre une troisième illustration de la mauvaise répartition grandissante des capitaux. Entre 2008 et 2020, l’encours des obligations notées BBB a plus que triplé, atteignant 3 500 milliards de dollars, soit 55 % de l’ensemble des titres de créance de première catégorie en 2020, contre 33 % en 2008. La concentration croissante des émissions d’obligations de première catégorie les plus risquées a accru les vulnérabilités du secteur des entreprises. Vulnérabilités qui se sont concrétisées au début de la pandémie de COVID-19 lorsque le nombre de notes BBB révisées à la baisse s’est révélé deux fois plus important que pendant toute la crise financière de 2008. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Réserve fédérale des États-Unis (« la Fed ») a dû intervenir pour stabiliser le marché des obligations d’entreprises du pays après le choc causé par la COVID-19.
Pendant la pandémie de COVID-19, les principales banques centrales sont entrées pleinement dans l’ère du post-monétarisme en achetant massivement des obligations à long terme. Le bilan de la Fed a très considérablement augmenté, passant de 4 200 milliards de dollars en mars 2020 à près de 9 000 milliards de dollars deux ans plus tard. Les banques centrales de la zone euro ont accru leur bilan de 4 700 milliards d’euros à 8 700 milliards d’euros, à la faveur de l’achat d’obligations par les États de la zone. Les obligations que détient la Banque du Japon augmentent chaque semaine, car elle maintient à 0,25 % le taux de rendement à dix ans face à la faiblesse du yen et à la hausse de l’inflation mondiale. En conséquence, les autorités monétaires des économies avancées ont constitué des portefeuilles d’obligations d’État de plus de 20 000 milliards de dollars, soutenant ainsi ces marchés au détriment des autres.
Pour l’instant, la Fed réduit son bilan au fil des mois en s’abstenant de renouveler les obligations qui arrivent à échéance. Cette situation a suscité des inquiétudes quant à la liquidité du marché obligataire des États-Unis, mais même au rythme actuel, il faudrait plus de quatre ans pour que le bilan de la banque centrale revienne ne serait-ce qu’à son niveau d’avant la COVID-19.
Il est important de noter qu’un nouveau concept de normalisation a vu le jour, en vertu duquel la Fed cherchera à maintenir les réserves bancaires en pourcentage du PIB. Les concepts antérieurs de normalisation de la politique monétaire présumaient une liquidation des titres obligataires de la Fed et une contraction correspondante des réserves bancaires. La politique de normalisation d’aujourd’hui et les prévisions de l’édition de mai du rapport sur les opérations de la Fed sur le marché libre (Open Market Operations report) indiquent que la Fed effectuera d’importants achats nets et bruts d’obligations souveraines vers la fin de cette décennie, de sorte que le choix des obligations qu’elle acquerra et le taux d’intérêt appliqué aux réserves utilisées à cet effet seront deux facteurs cruciaux pour le développement et la circulation des capitaux mondiaux.
Bien entendu, les politiques budgétaires changent radicalement en faveur d’un endettement public plus important dans les économies avancées. Cette évolution a des répercussions majeures sur les marchés financiers du monde entier, l’épargne disponible étant injectée dans les titres d’État. Pendant la pandémie, les pays ont emprunté massivement auprès des épargnants du monde entier, presque toujours pour soutenir davantage la consommation que la production. L’essentiel de ces dépenses ou la réduction de la fiscalité ont servi à soutenir les économies avancées, et souvent la consommation des particuliers aux revenus bien supérieurs au revenu médian. La demande a augmenté plus rapidement que l’offre, un déséquilibre qui est devenu plus visible avec l’émergence de chaînes d’approvisionnement en dehors de la Chine et le démarrage des processus de redressement et de réapprovisionnement au lendemain de la COVID-19.
S’agissant particulièrement du développement, des dépenses publiques importantes couplées aux émissions de titres de créance publics et aux achats d’obligations par les banques centrales ont eu pour effet d’allouer des montants croissants de capitaux mondiaux à un groupe restreint. L’achat et la détention d’obligations par les banques centrales déplacent les capitaux des petits épargnants vers les secteurs surcapitalisés des économies avancées. La réglementation bancaire a tendance à considérer explicitement de manière partiale que la dette souveraine des pays avancés est sans risque, tandis que les autres dettes, en particulier celles des petits pays, des pays en développement ou des nouveaux acteurs sur le marché, sont jugées risquées, nécessitant une capitalisation des banques sur fonds propres.
L’enjeu pour le développement est de savoir si les capitaux mondiaux suffiront pour financer les besoins en capitaux des gouvernements des pays avancés et s’il en restera assez pour répondre aux besoins d’investissement des pays en développement.
En 1990, Bob Lucas a développé un puzzle (baptisé plus tard « paradoxe de Lucas ») en montrant que même si les pays pauvres ont des niveaux de capital par travailleur inférieurs à ceux des pays riches – et donc des rendements potentiels plus élevés du capital ajouté – les capitaux circulent peu des pays riches vers les pays pauvres. Bien au contraire, c’est le scénario inverse qui s’observe généralement. De nombreux ouvrages proposent des explications à ce paradoxe, comme l’imperfection des marchés financiers, les institutions, le risque politique ou encore les externalités liées au capital humain.
L’assouplissement quantitatif semblait avoir modifié le paradoxe – du moins superficiellement. Cette mesure a contribué à atténuer l’aversion au risque à l’échelle mondiale et a réduit les coûts d’emprunt pour les marchés émergents. D’importants flux de capitaux en provenance des économies avancées ont inondé les pays en développement. Le problème est que ces apports de capitaux ont surtout bénéficié à l’État, et n’ont pas servi à la formation de capital ni à l’appui des investissements directs étrangers. La dette publique et privée totale des pays en développement a augmenté de 60 points de pourcentage du PIB depuis 2010, mais dans la plupart de ces pays, les investissements en pourcentage du PIB ont diminué. Cette réalité est l’une des évolutions les plus préoccupantes pour les perspectives de développement. Les niveaux élevés d’endettement rendent les pays en développement vulnérables aux chocs extérieurs et, en particulier, à la normalisation des politiques monétaires dans les économies avancées.
Pour ces dernières, la principale difficulté tient au fait que la politique budgétaire et la politique monétaire se recoupent de plus en plus, ce qui suscite de vives inquiétudes quant à l’indépendance de la politique monétaire. Le point de départ est la fixation des taux d’intérêt quand la dette publique est très importante par rapport au PIB. Deuxièmement, les intérêts croissants que les banques centrales versent aux banques commerciales sur la base d’un taux fixé par la banque centrale constituent clairement un empiètement entre les politiques budgétaire, réglementaire et monétaire. Troisièmement, la gestion du passif des banques centrales, évoquée plus haut, a connu une croissance astronomique, créant des problèmes d’ordre financier. À mesure que les autorités financières et monétaires s’adaptent aux décisions des unes et des autres concernant les échéances des prêts des banques centrales, les politiques s’entremêlent de plus en plus. Et quatrièmement, le recoupement le plus important est peut-être lié à l’ampleur sans précédent de l’asymétrie des échéances appliquées par les banques centrales lorsqu’elles financent des portefeuilles d’actifs à long terme grâce à des réserves bancaires accumulées du jour au lendemain et à des prises en pension de titres. Les écarts d’échéances n’affectent pas seulement les flux de capitaux mondiaux et les politiques de réglementation financière, ils ont également des répercussions institutionnelles. À mesure que la valeur comptable des banques centrales diminue et qu’elle est susceptible de devenir négative sous l’effet de la chute actuelle des cours mondiaux des obligations d’État en dehors du Japon, le besoin des banques centrales en soutien politique absolu augmente. Ces problèmes peuvent être réglés, mais l’inquiétude vient du fait qu’ils soient suffisamment graves pour prolonger la pénurie de capitaux d’investissement en faveur du développement. La plupart des économies avancées imposant peu de plafonds statutaires ou constitutionnels aux emprunts, on peut s’attendre à ce que cette tension se poursuive, en particulier en période de ralentissement de l’activité économique.
Durant les années post-monétarisme, l’assouplissement accru des politiques budgétaires et monétaires s’est principalement répercuté sur les prix des actifs dans les économies avancées. Cette mesure profite aux riches qui détiennent ces actifs plutôt qu’à l’ensemble de la population, à un moment où les inégalités atteignent des niveaux quasi inédits. La croissance du revenu médian est à la traîne, à quelques exceptions près ; pour les pays en développement, les entrées de capitaux ont essentiellement soutenu les dépenses et les portefeuilles d’actifs de l’État, contribuant peu à l’investissement direct étranger ou la formation brute de capital fixe.
Pour remédier à ce déséquilibre, il faudrait faire clairement comprendre que l’augmentation de la production est un objectif stratégique au même titre que les flux de capitaux à l’appui du développement fondés sur le jeu du marché. Pour répondre à la forte inflation, plusieurs instruments, hormis la hausse des taux d’intérêt, peuvent être appliqués : premièrement, créer les conditions d’une augmentation de l’offre en réponse à la hausse des prix ; les marchés étant prospectifs, la seule annonce d’une offre future par les investisseurs privés et les États pourrait s’avérer utile ; deuxièmement, dans les économies avancées, réduire le montant des dépenses publiques courantes et améliorer l’efficacité en ciblant davantage les pauvres et les vulnérables ; cela réduirait la demande improductive et laisserait aux marchés financiers mondiaux une plus grande marge de manœuvre pour financer les investissements, ce qui diminuerait la pression sur l’inflation ; et troisièmement, réduire l’échéance des titres obligataires actuels et futurs détenus par les banques centrales ; cela enverrait aux marchés un signal indiquant que les capitaux peuvent être orientés vers d’autres actifs, tels que les capitaux à taux variable à court terme dont ont besoin les petites entreprises pour accroître la production mondiale.
Ces ajustements des politiques macroéconomiques amélioreraient la répartition des capitaux mondiaux, offriraient un moyen de réduire l’inflation, augmenteraient la valeur d’un ensemble plus large d’actifs et relanceraient la croissance du revenu médian, qui est essentielle à une prospérité partagée. L’autre solution est le maintien du statu quo, dont les manifestations sont le ralentissement de la croissance mondiale, la hausse des taux d’intérêt, une plus grande aversion au risque, la fragilité dans de nombreux pays en développement.
La crise qui menace le développement prend de l’ampleur. Les pays en développement sont au milieu de l’une des phases les plus synchrones de resserrement des politiques monétaire et budgétaire à l’échelle mondiale de ces 50 dernières années. Les banques centrales des pays en développement sont déjà confrontées à des dilemmes macroéconomiques cruciaux. Pour juguler l’inflation néfaste due aux prix des denrées alimentaires, de l’énergie et d’autres biens et services importés et nationaux, les banques centrales des pays en développement doivent relever leurs taux d’intérêt de même que les coûts d’emprunt appliqués au secteur privé. Ces mesures s’imposent d’autant plus que la quête de rendement se mue en une quête de sécurité, précipitant les sorties de capitaux et la dépréciation des monnaies nationales. En outre, l’aversion pour le risque d’investissement à long terme est de plus en plus forte. Les répercussions négatives sur la croissance sont déjà visibles. Dans le même temps, cette nouvelle crise qui survient au lendemain de la COVID-19 trouve des pays en développement fragilisés sur le plan financier, avec notamment des niveaux d’endettement élevés et des recettes budgétaires en berne. Les pays ne disposent pas d’une marge de manœuvre budgétaire suffisante leur permettant de soutenir les dépenses essentielles en faveur de la croissance et du développement.
Il est urgent d’accroître les dépenses consacrées à l’éducation et à la préparation aux situations d’urgence dans le secteur de la santé. Les gouvernements des pays en développement devront dépenser plus efficacement les maigres ressources budgétaires affectées à ces secteurs. Il est crucial d’investir dans les infrastructures pour créer des emplois à court terme et favoriser la croissance à moyen terme. En période de crise, ces investissements essentiels passent souvent au second plan. Nous devons déjouer cette tendance historique en élargissant la participation du secteur privé et en optimisant les bilans souvent importants des entreprises publiques.
On peut aussi répondre aux besoins financiers en adoptant des mesures résolues visant à élargir les assiettes fiscales et à améliorer l’efficacité du recouvrement. L’allégement de la dette par les créanciers bilatéraux et commerciaux sera aussi un facteur déterminant dans les pays les plus endettés. En effet, l’ampleur potentielle de la crise de la dette qui se profile élève les enjeux et pourrait inciter toutes les parties à trouver une solution viable.
Dans le même temps, la crise climatique provoquée par les émissions de gaz à effet de serre continue sa marche inexorable. Les catastrophes naturelles liées au climat retentissent sur la production agricole, les moyens de subsistance des populations dans tous les secteurs de l’économie et les migrations. Pour soutenir l’action climatique, de nombreux pays en développement ont besoin d’investissements massifs, de financements concessionnels et de dons qui faciliteraient leur transition dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’agriculture. Des sources de financement importantes sont également nécessaires pour accompagner l’adaptation au changement climatique et le renforcement de la résilience dans la plupart des pays en développement. L’un des grands axes de notre Plan d’action sur le changement climatique consiste à recenser des politiques et des projets concrets susceptibles de produire un impact dans ces domaines, et à mettre en place des instruments et mécanismes de financement destinés à aider la communauté mondiale à promouvoir les biens publics mondiaux dans les pays en développement. Nous collaborons avec les partenaires publics et privés, les actionnaires et les parties concernées sur ces défis, conscients qu’il reste beaucoup à faire dans ces domaines.
Pour surmonter cette véritable tempête et regagner le terrain perdu sur le front du développement, de nouvelles stratégies macroéconomiques et microéconomiques doivent être adoptées dans les pays avancés comme dans les pays en développement. Les nouvelles quotidiennes sur l’inflation, le changement climatique, la famine, les troubles civils et la violence indiquent clairement que nous devons agir rapidement. Le Groupe de la Banque mondiale affronte résolument ces défis en s’appuyant sur des évaluations réalistes, et est prêt à rechercher des solutions, notamment en collaborant avec vous tous qui êtes là aujourd’hui.
Je vous remercie de votre attention.